PHYSIQUE
Réactions nucléaires
1. Le noyau atomique.
A. L’atome.
L’atome est constitué :
d’un noyau, constitué de nucléons, les protons et les neutrons.
d’électrons
Le nombre de protons (et d’électrons) est le numéro atomique, noté Z (ou nombre de charge).
Le nombre de nucléons est le nombre de masse, noté A.
![]()
![]()
B. Définitions.
Nucléide : c’est l’ensemble des atomes ayant le même noyau.
Élément chimique : c’est l’ensemble des particules qui ont le même numéro atomique.
Isotope : c’est l’ensemble des particules qui ont le même numéro atomique mais un nombre de masse différent.
Unité de masse atomique : par
définition, l’unité de masse atomique est le douzième de la masse de l’atome
isotope 12 du carbone.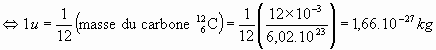
Comme la masse des électrons est négligeable, la masse du noyau peut-être assimilée à celle de l’atome. On a aussi :
![]() .
.
C. Stabilité des noyaux et énergie de liaison.
Interaction attractive entre nucléons :
interaction forte s’exerce entre les nucléons, supérieure à l’interaction
électrostatique répulsive entre les protons. La cohésion du noyau est donc
assurée.
Énergie de liaison : c’est l’énergie qu’il faut fournir au noyau au repos pour le dissocier en ses nucléons séparés au repos.
Énergie moyenne de liaison par
nucléon : c’est l’énergie de liaison divisée par le nombre de
masse : ![]()
.
2. Lois de conservation.
Lors d’une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de masse A et conservation du nombre de charge Z.
Par ailleurs, il faut noter qu’il y a conservation de l’énergie. En effet, lors de ladésintégration, il y a transformation de l’énergie de liaison des nucléons en énergie d’une
autre forme : de l’énergie rayonnante puisqu’il y a émission de rayons et de l’énergie
cinétique qui se manifeste par la vitesse des neutrons expulsés.
3. Radioactivité.
A. Définition.
On appelle radioactivité la propriété qu’ont certains corps de se désintégrer
spontanément pour en devenir d’autres en libérant de l’énergie et en expulsant des
neutrons. Il y a à cette occasion émission de rayons.
B. Émissions radioactives.
Nature des émissions :
Particules chargées :
Particules
, constituées de noyaux d’hélium
.
Particules
: ce sont des électrons symbolisés par
.
Particules
: ce sont des positrons symbolisés par
.
Particules neutres : le neutrino
, de symbole
, et l’antineutrino
, de symbole
, ont une charge nulle et se déplace à la vitesse de la lumière.
Rayonnement
: c’est un rayonnement électromagnétique, qui transporte de l’énergie.
Détection : les particules
chargées et le rayonnement ![]() peuvent être détectés grâce à leur pouvoir ionisant fort, à l’aide
d’un compteur de Geiger-Müller.
peuvent être détectés grâce à leur pouvoir ionisant fort, à l’aide
d’un compteur de Geiger-Müller.
4. Différents types de réactions nucléaires spontanées.
A. Désintégration
a.Un noyau père se désintègre en un noyau
fils par émission d’une particule ![]() .
.
Il y a émission d’un noyau d’hélium ![]() :
:
![]()
Ex : le radium : ![]()
B. Désintégration b-.
Un noyau père se transforme en un noyau
fils en émettant une particule b-, c’est
à dire des électrons, ainsi que des antineutrinos : ![]()
Ex : le carbone : ![]()
L’émission d’un électron et d’un antineutrino provient de la décomposition d’un
neutron de symbole ![]() en proton de symbole
en proton de symbole ![]() :
: ![]()
C. Désintégration b+.
Un noyau père se transforme en un noyau fils en émettant une particule b+, c’est à dire
![]()
L’émission d’un positron et d’un neutrino provient de la décomposition d’un
proton en neutron : ![]()
D. Rayonnement g.
La formation d’un noyau fils s’accompagne parfois d’un rayonnement
magnétique de grande énergie, le rayonnement g. Certain noyaux sont en effet
excité, et la désexcitation crée ce rayonnement g :
![]()
5. Décroissance radioactive.
A. Propriétés des transformations radioactives.
La radioactivité est un phénomène :
essentiellement nucléaire.
spontané et inévitable.
aléatoire.
B. Période radioactive.
La période ou demi-vie T d’un radionucléotide est la durée nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux initialement présents dans un échantillon.
Au bout de n période, la quantité de noyau restant est :
![]()
C. Activité.
L’activité A d’un échantillon de substance radioactive correspond au nombre
moyen de désintégrations par unité de temps.
Unité : le Becquerel 1 Bq = 1 désintégration par seconde.
On a :
, où N est le nombre moyen de noyaux radioactifs.
6. Réactions nucléaires provoquées.
A. Définition.
Une réaction nucléaire provoquée engendre de nouveaux noyaux par chocs d’une particule ou d’un noyau projectile sur un noyau cible.
Les réactions nucléaires provoquées comme les réactions nucléaires spontanées vérifient les lois de conservation de la charge et du nombre de nucléons.
B. Réaction de fission nucléaire.
Définition : une réaction de fission est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd se scinde en deux noyaux légers sous l’impact d’un neutron lent, en libérant d’autres neutrons et de l’énergie.
Les nucléotides sont dits fissiles.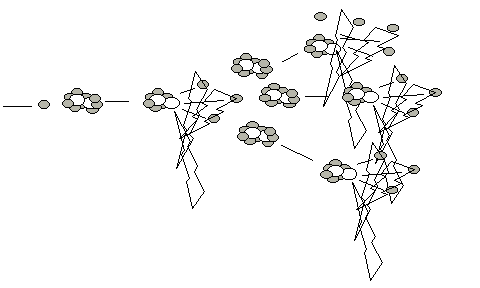
On a une réaction en chaîne : certain neutrons libérés provoquent de nouvelles fissures.
Exemple : ![]()
C. Réaction de fusion nucléaire.
Définition : une réaction de fusion est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle deux noyaux légers s’unissent, à température élevée, pour donner un noyau lourd, et de l’énergie, en émettant un rayon g . C’est une réaction thermonucléaire.
![]() Equation-
bilan :
Equation-
bilan :
Schéma :
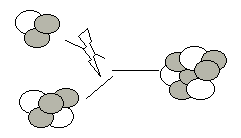
D. Réaction de transmutation.
Un noyau précédemment stable devient radioactif par l’action d’un
rayonnement radioactif dû à un autre noyau radioactif : dans un premier
temps, un noyau radioactif se désintègre pour devenir stable. il émet un
rayonnement qui rend l’autre noyau radioactif : ![]()
Puis cet autre noyau va se désintégrer pour redevenir stable :
![]()